
Jota Mombaça | A CERTAIN DEATH/THE SWAMP
Les ruptures apocalyptiques hantent. Les traces de leur apparition subsistent dans le sol épuisé des plantations de sucre jamaïcaines ; le long des pistes océaniques du Middle Passage sur les voies navigables intérieures de l’Amérique du Nord ; sur les côtes sénégalaises de l’île de Gorée et bien plus haut, parmi les machines abandonnées d’une mine de zinc au sud-est d’Alger ; sur les tuiles d’une maison palestinienne ancestrale rasée à Jaffa ; comme des particules radioactives planant au-dessus d’Hiroshima, vers le site d’essai de Maralinga dans les régions occidentales reculées de l’Australie méridionale. Partout où la modernité coloniale et ses modes de production et d’appropriation capitalistes ont débarqué – c’est-à-dire partout – des ruptures se sont rapidement déployées à des échelles à la fois imperceptibles et frappantes, s’installant dans une crise permanente de la vie planétaire elle-même. W.E.B. Du Bois a publié la plupart de ses courtes œuvres de fiction dans le sillage de la Reconstruction américaine et de son échec à éradiquer la domination blanche, ce que Saidiya Hartman appelle le “non-événement de l’émancipation”. Dans ses écrits spéculatifs, Du Bois a chargé ce non-événement de visions apocalyptiques et d’images bibliques – un moyen pour lui d’enregistrer un temps et un lieu qui renonçaient à l’esclavage mais persistaient à se façonner à travers la non-liberté des Noirs, permettant à son tour de “déplacer l’idée d’apocalypse loin de la dévastation mondiale et vers les conditions de la vie de tous les jours”.
Jota Mombaça est également hantée par l’apocalypse. Il est cependant difficile de savoir dans quelle direction elle regarde ou est appelée. La hantise est multidirectionnelle, traversant des chemins battus et inconnus. L’artiste, performeuse et écrivaine née au Natal fait face à l’épave – son existence et son éventualité – d’une manière analogue à celle de Du Bois : ni dans la peur ni dans l’exaltation, mais plutôt en reconnaissant que le présent est déjà saturé de conditions engendrées par des apocalypses passées et futures qui requièrent son attention, et la nôtre. C’est à travers et contre ces conditions présentes, qui produisent ce que Mombaça appelle des “états d’attente forcée”, que son travail est appelé à fournir un espace de réflexion pour le deuil. Faire le deuil, ici, c’est s’occuper simultanément de ce qui a été perdu et de ce qui pourrait encore être récupéré. Pour l’artiste, cela nécessite d’étendre le temps de la traite transatlantique des esclaves au temps géologique – les transformations environnementales que nous enregistrons aujourd’hui ont déjà bourdonné sans cesse depuis l’extermination (en cours) des mondes de vie indigènes. Ce processus d’étirement nécessite une sorte de voyage dans le temps, un défi aux lois de la physique. Il ne peut se manifester qu’à travers des gestes performatifs, des fabulations critiques, des expérimentations matérielles, tous caractéristiques de la pratique esthétique et discursive de Mombaça.


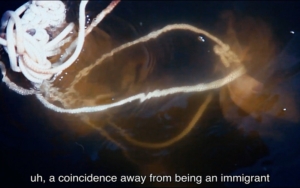
A CERTAIN DEATH/THE SWAMP, l’exposition de l’artiste Jota Mombaça au CCA Berlin – Center for Contemporary Arts, a été conçue, au départ, à partir de conversations approfondies sur la curieuse topographie de Berlin, dont on dit qu’elle est entièrement construite sur des marécages asséchés. Du marais à la ville, une téléologie du progrès, un plan de survie, émerge. En se penchant sur les inondations dévastatrices de 2021 qui ont touché certaines parties de la Belgique, de l’Allemagne et des pays voisins, Mombaça évoque ensuite un renversement : qu’en est-il des villes qui se transforment à nouveau en marécages, une forme de dissolution dont les fascistes avaient peur (“Drenare la palude !”, a hurlé un jour un Benito Mussolini déterminé) tout au long du vingtième siècle ? De la localité de Berlin, nous déplaçons notre regard vers un problème planétaire : celui des phénomènes atmosphériques qui menacent continuellement de s’effondrer dans des zones géographiques disparates. Jusqu’au dernier matin (2023), une œuvre vidéo nouvellement commandée, a été tournée parmi les mangroves et les marais de Pará, dans l’Amazonie brésilienne. Couvrant environ 700 000 hectares, ces mangroves et marais dépendent d’un afflux constant d’eau douce provenant des précipitations et des rivières et ruisseaux de la baie de Guajará. Pour ce faire, la caméra se tourne vers le ciel, observant les formations nuageuses, leurs mouvements et leurs manœuvres. La survie de l’écosystème dépend de cette chorégraphie imprévisible – observer le temps qu’il fait, c’est donc prévoir si une ligne de continuité peut être tracée dans le futur.
Christina Sharpe associe l’esclavage, et les monstrueux régimes anti-Noirs qui l’ont engendré, au temps qu’il fait : “L’esclavage n’était pas singulier ; c’était plutôt une singularité – un événement ou un phénomène météorologique […] Le temps nécessite le changement et l’improvisation ; c’est la condition atmosphérique du temps et du lieu ; il produit de nouvelles écologies”. En accord avec le temps, Mombaça a fabriqué des récipients en céramique, ou plutôt des collecteurs de pluie, qui ont été immergés pendant un mois au fond du lac Waldsee avant d’être récupérés. Les récipients, dans leur forme amorphe, portent désormais les traces de l’eau et de ses propriétés. Par cet acte d’immersion, que l’artiste décrit comme une “possession élémentaire”, l’eau est invitée à s’emparer des objets. Le sol boueux semble lui aussi envahir tous les coins de l’espace d’exposition, menaçant de l’engloutir tout entier. Des empreintes d’argile sont suspendues au-dessus du sol de manière désordonnée et portent des inscriptions illisibles. Le seul texte que l’on puisse déchiffrer est le suivant : “Oui, j’ai peur : “anticipation (at dawn) (2023), une peinture faite de charbon de bois et de pigments, met en scène une Weltlandschaft perdue dans la traduction.
Passant de Berlin à l’Amazonie brésilienne et inversement, comme des masses d’eau s’écoulent dans le lit et sur les rives d’un canal, Mombaça tente de capter un climat total. On pourrait dire qu’elle apprend aussi à devenir une passante, naviguant dans les mondes dans leur différence mais dans la singularité de notre destin collectif. Achille Mbembe nous rappelle que “passer d’un lieu à l’autre, c’est aussi tisser avec chacun d’eux une double relation de solidarité et de détachement”, élaborant une “éthique du passant” en dialogue avec Frantz Fanon et Édouard Glissant, il professe que parler d’un lieu dans un autre, c’est appartenir à tous les lieux ensemble, c’est habiter un monde en relation, où toute occurrence trouve aussi son écho ailleurs.
Texte : Edwin Nasr
Projet en partenariat avec la Fondation Calouste Gulbenkian – Délégation en France dans le cadre du programme PARTENARIATS GULBENKIAN pour soutenir l’art portugais dans les institutions artistiques européennes.



